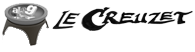Lire Bouillier c’est entrer dans la tête de l’auteur. Pas de la fiction, mais une certaine vision de la réalité qui est à la fois délirante et lucide. Bouillier, dans Le Dossier M, n’invente rien (ou presque): il livre sa version des faits, à «son niveau individuel des choses» comme il le répète si souvent, et cette version est complètement hallucinante parce qu’il ne voit pas les choses comme les autres, ou plutôt comme on voudrait nous faire croire que les autres les voient, car que voient-ils vraiment? Si tout le monde parlait à cœur ouvert comme Bouillier le fait, peut-être que l’on découvrirait que la réalité (ce qu’on appelle la réalité) est tout autre.
C’est comme ce cartoon que j’ai déjà vu sur les internets, celle de l’autobus où chacun évite le regard des autres, perdu dans ses pensées et qui se questionne «Pourquoi tout le monde agit comme des moutons, suis-je le seul à m’en rendre compte?» Et parce qu’on ne veut surtout pas passer pour fou, on agit comme les autres, et finalement tout le monde agissent comme des fous parce que c’est cette normalité qui est aberrante.
M’enfin je m’égare. Bouillier. Dossier M. De quoi s’agit-il? Succinctement: c’est Bouillier qui tombe (littéralement) en amour (de très haut, la chute est fracassante) et qui tente de s’en remettre. Banal? Oh oui, dit comme ça, c’est très banal. Et au premier niveau, ce l’est. Pourtant ce n’est qu’un prétexte.
Car je ne m’égarais pas vraiment. Bouillier a le don de (nous faire) voir ce qui est aberrant. Un banal prétexte donc pour nous emmener dans une escapade rocambolesque à travers les circonvolutions enchevêtrées de ses mille niveaux d’observation de la réalité (ce qu’il dit être sa réalité), par exemple:
comment Dallas (la série) a transformé le monde pour le pire et qu’on vit maintenant dans ce renversement des valeurs;
comment la télévision a perverti radicalement notre rapport au monde (certes il n’est pas le premier à le dire, d’autres l’ont analysé plus finement que lui à la limit, mais lui nous le fait voir);
comment le rugby (et tous les sports d’ailleurs) ne sont plus ce qu’ils étaient, entre autres à cause de la télé et du capitalisme;
comment il était impossible de donner la parole à des Serbes durant la guerre de Bosnie;
l’effet de la richesse sur les riches et leur niveau individuel des choses;
le message cachée des pubs (la vie à vendre, le temps de cerveau disponible);
la mort comme projet de vie;
le spectacle le plus incroyable de Miles Davis où la sono s’était bousillée et où Davis se mit à interpréter seul, sans support, un morceau de trompette a capella, ce qui avait soufflé la salle (Bouiller entoucas);
le bad beat du poker comme manière d’expier un crime;
les scènes de films analysés à la seconde près;
la chanson Summertime et ses innombrables reprises;
Picasso qui peint en direct et l’échec comme aventure plus enivrante que la réussite;
l’histoire complètement a-hu-rissante de Donald Crowhurst faisant le tour du monde à la voile en solitaire, sa vérité dans la tricherie qu’il s’est fait voler parce que l’improbable-impensable est advenu;
etc. et j’en passe.
Ce n’est qu’un (bref) échantillon.
La fin de l’histoire? On s’en torche.
C’est le processus qui compte.
C’est le jeu de serpents et échelles dans les dédales de parenthèses d’explication dans des parenthèses d’explication dans des parenthèses d’explication qui aboutissent à former un panorama de compréhension fine, aiguë, lancinante de la réalité (ce mot qui n’est qu’un mot fourre-tout finalement, un leurre pour tromper la curiosité, une façade pour simplifier, comme Dieu dit tout et dit rien). Ce qui compte, c’est prendre le temps de passer par quatre chemins pour voir le paysage, goûter les couleurs, sentir les sons, s’émerveiller devant ce spectacle à nul autre pareil. Le but n’est pas d’arriver quelque part, mais d’être là où on est, où il est, lui, et où il nous invite à le rejoindre, c’est-à-dire à notre niveau individuel des choses, voilà ce qui compte. Voilà, l’important. Voilà qui fait la différence entre vivre et exister.
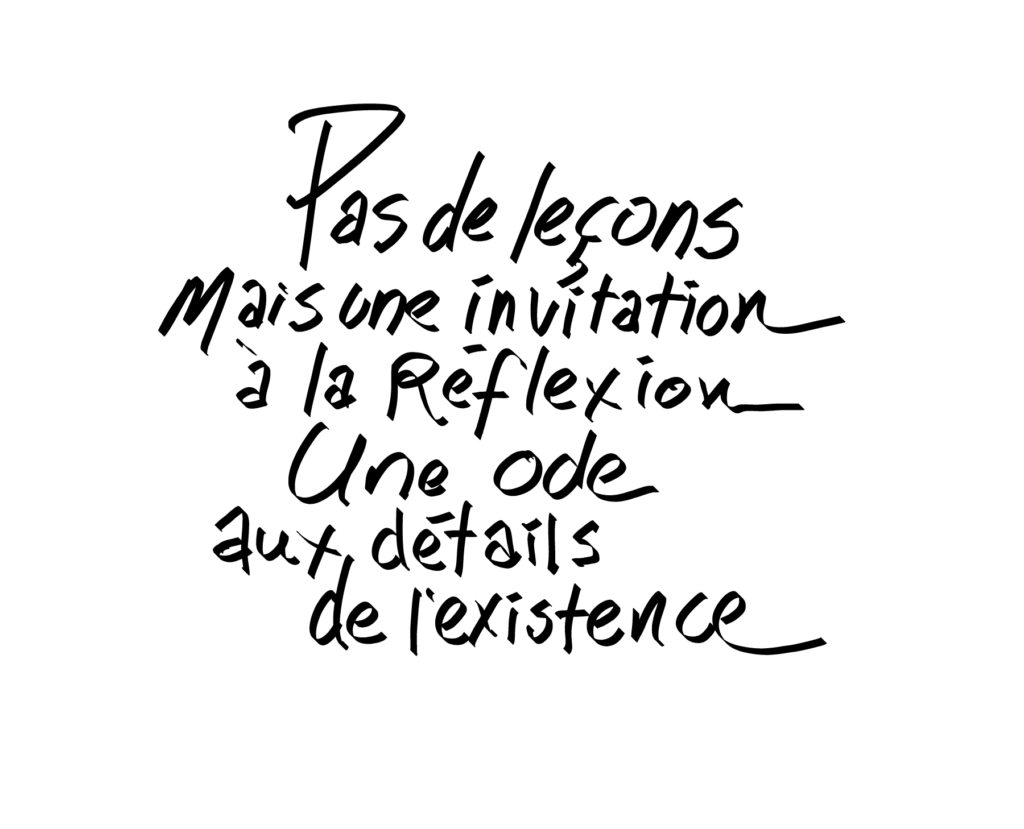
Ce faisant il peint une fresque où la reprise de ses digressions forment des motifs qu’il reprend inlassablement et qui ajoutent des couches de sens sans fin, où il affine toujours plus son propos pour livrer non pas des leçons de vie, mais des invitations à la réflexion, une ode aux détails de l’existence, les aspérités comme les douceurs, les plus grandes comme les plus petites; c’est, d’une certaine manière, une invitation à incanter cette magie qui surgit quand on se donne la peine de ne pas naviguer les événements sur le pilote automatique, mais de les prendre de front, c’est-à-dire d’accepter en toute humilité que tous ces événements nous dépasse finalement de loin, nous surplombe, nous passe dessus comme un dix-roues; et cette magie naît du lâcher prise, dans la compréhension que de tout vouloir contrôler et tout comprendre, en fin de compte on ne contrôle rien et on ne comprend pas grand-chose, et qu’en lâchant prise les motifs finissent par se révéler, un peu comme s’il fallait purger sa peine pour être libre; que c’est sommes toutes dans l’obsession d’être pleinement attentif à ce que la vie fait de nous que l’on peut savourer les multiples couches de sédiments qui se déposent en notre for et forment les strates de notre vécu et de notre revécu; que si l’on se tient à la surface, on passe à côté du mystère, l’important n’est pas la fresque telle qu’on la voit au premier coup d’oeil, mais bien toutes ces tentatives, ratées, essais, cul-de-sac qui s’y cachent et qui font la réelle beauté de l’oeuvre, entendu comme chose vivante, comme processus qui n’a pas de fin, ou du moins qui ne trouve son point final que dans la mort; que tant que nous sommes vivants, il y a de l’archéologie à déterrer, de la généalogie à lier, de l’arborescence à fructifier, de l’exploration intersidérante dans un incessant jeu de va-et-vient dont la méprise et la reprise sont les instruments de prédilection.
À déguster à petites doses ou à s’empiffrer, au choix. C’est une putain de brique. Deux briques en fait, là où j’en suis. Voir plus si vous avez l’estomac solide, j’ai vu qu’il y a les livres 3 à 6 en plus. Qu’est-ce qu’il a encore à dire après tout ça??? C’est intrigant.
Allez lire sa tirade sur Dallas pour vous donner une idée du style. Si vous aimez, plongez tête première.