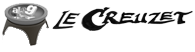Il était une fois Pense aux pierres sous tes pas d’Antoine Wauters publié chez Verdier.
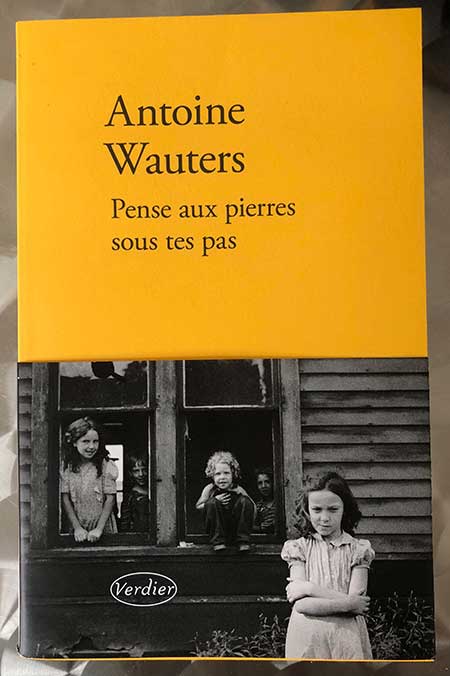
Cette fois-là se passe dans un pays imaginaire « dont on ignore le nom », un pays fictif qui pourrait bien être le nôtre ou le voisin ou encore celui dont on entend parler aux nouvelles, car c’est bien de notre monde où règnent les ombres dont il est question, et les toponymes ont des consonances qui semblent familières tout en étant exotiques (d’un point de vue purement québécois) : la région de Habdurga, la ville de Santa Lucia, Sassaru, la capitale, la Costa Lolla, le fleuve Irrighudu, le village de Castel Posino…
Ça pourrait être un de ces pays qui font trop (ou pas assez?) souvent les nouvelles (même si ces nouvelles sont toujours aussi superficielles et éphémères), une contrée où la misère se jette constamment sur le pauvre monde, un pays fictif d’un tiers-monde trop réel où le président Desotgiu règne en dictateur depuis 20 ans, depuis qu’il a délogé l’ancien président-dictateur.
Un scénario national d’une obscénité ordinaire et banale.
« Depuis vingt ans, Desotgiu nous prenait quatre-vingt-dix pour cent de nos recettes pour se faire construire des propriétés de luxe sur la côte. Depuis vingt ans, on croulait sous les taxes, des tas de gens se retrouvaient à dormir par terre comme des chiens verruqueux, mais tout ça nous semblait “normal” (on préfère oublier les choses qui font mal, oublier la façon violente dont on naît, dont on meurt, dont on se sépare, on préfère ne rien dire et, tant qu’il nous reste un filet de souffle, faire l’autruche et vivre malgré tout). »
Il était cette fois-là deux jumeaux qui vivaient dans le sud aride, le garçon à travailler aux champs et à prendre soin des bêtes avec son père, la fille à faire les corvées à la maison avec sa mère, une vie de petites misères sans autres horizons que ceux de la nature à perte de vue au-delà des champs et des fleuves dont l’immensité a quelque chose d’indicible.
C’est l’histoire d’un amour interdit entre frère et sœur qui, surpris par le père lors de leur fornication, se voient séparés, les parents décidant d’envoyer la fille vivre chez son oncle.
C’est donc une histoire d’amour et de séparation :
« Je songeais qu’être séparé de quelqu’un, c’est être séparé non pas une fois seulement et pour de bon, mais des tas de fois, pendant des jours, des mois et des années, jusqu’à ce que le manque, enfin, en ait assez de vous butiner le cœur. Voilà, je me disais : être séparé, c’est être séparé des tas de fois, pendant des mois et des années, jusqu’à ce que le manque en ait assez et vous laisse peu à peu en paix, si c’est possible. »
Ainsi, la perte est au cœur de l’œuvre.
C’est le deuxième livre belge que je lis depuis mon retour de Bruxelles et les deux indiquent en annexe de quels auteurs ils ont pris certains passages. Sur la perte, il y a cette phrase-ci, de Carlo Bordini :
« Ce qu’on perd est irrécupérable. Et si on le récupère c’est désormais dispersé, ça ne rentre plus dans l’ordre des choses. »
Ça doit vous sembler une histoire triste et glauque, han?
Bein c’est étonnamment tout le contraire! La perte n’est qu’une facette de la médaille…
Pense aux pierres sous tes pas, c’est un récit sur la joie de vivre malgré la misère, sur la prise en charge de destinées meurtries afin de goûter un peu la vie dans tout ce qu’elle a d’aigre-doux, sur l’amour parfois (souvent?) mal exprimé des parents envers leurs enfants, sur la liberté arrachée à la sueur de son front aux contraintes étatiques et sociales.
« Les mots que vous allez lire n’ont d’autre ambition que de témoigner de notre histoire, depuis notre enfance compliquée jusqu’aux temps de l’apaisement.
« On ne nous a pas payés pour le faire.
« On n’en a rien à foutre d’être payés.
« On voulait le faire parce qu’on ne dit pas assez que les ombres peuvent être terrassées.
« Et qu’on a tous besoin de clarté. »
Quelle clarté?
« Ensemble, on chanta toute la nuit en hommage à la vie, cette horreur délicieuse. On but comme des ivrognes au son de nos flûtes de roseau. »
Ou encore : « Le bonheur, comme toutes les bonnes choses, se cache. Mais il est dans chaque pas, chaque minuscule seconde et il suffit parfois de fermer les yeux, simplement, pour le trouver. »
C’est un récit sur le prix à payer pour vivre vraiment :
« Peut-être qu’on doit payer?
« Que c’est ça, le destin?
« Payer pour les fautes qu’on a commises.
« Payer pour nos passions. Nos amours.
« Peut-être. »
C’est l’histoire de l’enfance qui s’étiole trop souvent dans l’âge adulte :
« Allez comprendre ceci : toute notre enfance, on vécut dans un temps hors du temps, où l’espoir enjambait le mal. »
Certains thèmes évoquent le bouddhisme, dont cette phrase reprise de Roberto Juarroz : « Il faudrait nous demander ce qui pourrait arriver si, un jour, nous nous endormions tous à la fois, les hommes et les choses. Ou bien si nous parvenions à l’inverse, à nous réveiller entièrement tous ensemble. »
Cet autre passage m’y fait penser également :
« Et si c’était toujours le même chemin? je disais afin de survivre. Si tout n’était qu’une danse, qu’on ne faisait que tourner en rond avec l’espoir ou l’illusion d’avancer, faute de mémoire, mais qu’on repassait toujours par les mêmes points? T’en penses quoi, ma sœur? »
Idem pour la clarté, la vie et la mort :
« Lorsque le soleil vous entaille les yeux, c’est douloureux, pourtant vous les ouvrez plus grands encore et vous souriez. Vous vous asseyez face au fleuve et laissez l’air entrer en vous. Et si j’étais morte? vous dites-vous soudainement. Si tout ce qui m’arrivait n’était qu’un peu de bruit dans ma tête? »
Enfin, sur le changement et le bonheur :
« Maintenant que je suis vieille et que tout a repris sa place, je vois les choses différemment. Votre vie peut avoir mille visages, mille rebonds, vous pouvez naître et mourir tant de fois, naître et mourir encore, l’essentiel ne change pas : vous ne changez pas. Vous restez celui que vous êtes depuis toujours. […] Vous ne pouvez être que vous-mêmes. Le changement n’existe pas vraiment.
« […] Ce qui paraît changer, c’est le tracé que prend votre chemin. C’est sa couleur. […]
« Je le dis plus clairement encore, si c’est possible : quoi que vous fassiez, quoi que vous perdiez, quoi que vous acquériez, vous restez avec vos fantômes. Avec vos peurs couleur corbeau. Avec vos manques venus de l’enfance.
« Est-ce que c’est triste?
« Non.
« Car vous restez aussi avec votre joie. Dans ce bonheur qui se cache, mais qui est le vôtre depuis toujours.
« Ce bonheur, même si on savait bien qu’il ne serait pas entier, on décida de le retrouver. On en avait ras-le-bol d’attendre du ciel qu’il se déchire. Alors, on déplaça notre joie où elle aurait sa place. Où il fallait qu’elle soit. Où elle pourrait grandir. Croyez-moi, c’est à peu près la seule chose que vous puissiez faire de votre vie. Cultivez votre joie. Le reste n’a pas d’importance. »
Sur un ton plus rebelle :
« Je le dis comme je le pense : vous avez en vous quelque chose qui vous guide. Une force. Un souffle. C’est à ça qu’il faut s’accrocher. À cette force qui vous tient, à cette puissante musique qui vous rend sourd depuis toujours, et qui jetait vos parents dans des rages noires. Tant que vous gardez ça à l’esprit, vous êtes contents que les jours se rajoutent aux jours. Vous êtes dans ce bonheur qui se cache mais qui pourtant est le vôtre. Fiez-vous à ces choses : à votre instinct autiste. À vos grandes solitudes. Le reste n’existe pas. »