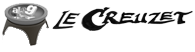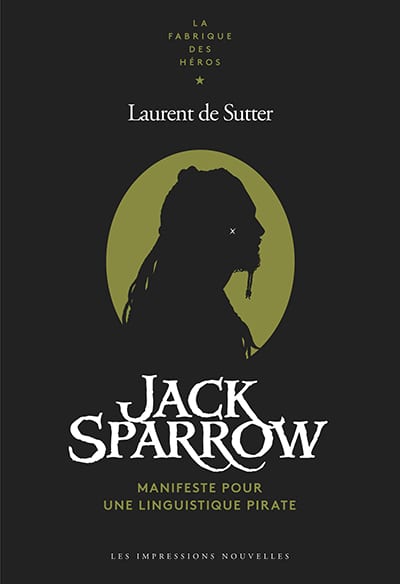
La question au cœur de l’œuvre est celle-ci: Jack Sparrow est-il le pire ou le meilleur pirate de tous les temps?
De Sutter répond: il est le meilleur en bonne partie parce qu’il est le pire!
Manifeste pour une linguistique pirate aborde ce personnage désormais mythique avec une bonne dose d’érudition mélangée à une analyse finement ciselée des œuvres cinématographiques le mettant en scène. Et beaucoup beaucoup d’humour. Et peut-être aussi beaucoup beaucoup beaucoup de rhum. (Ça me donne soif, tout ce beau coup de rhum. Ahr.)
Amateur de piratologie, je puis, grâce au peu que j’en connais, me permettre de juger que de Sutter a étudié la question — du reste, les références académiques en font foi (car faut pas se fier aux autorités, moussaillons, y’a des forbans partout).
Sparrow est le meilleur de tous les pirates parce qu’il a la langue bien pendue, que ses actes de bravoure faussement intéressés et très très mal calculés, ainsi que sa chance surréelle font de lui une légende vivante (parfois de justesse), à laquelle il contribue en abusant du langage à toutes les occasions. Sans. Cesse.
Contextualisons : durant l’âge d’or de la piraterie (dont les dates j’omettrai sciemment de préciser parce qu’il vaut mieux laisser les choses dans le flou afin d’amoindrir le risque de se faire coincer), les pirates forment une caste à part, se drapent de leur marginalité et esquivent les autorités autopatentées des continents afin de goûter la liberté. (Son goût, à la liberté, varie de l’eau de mer parfumée au varech à celui du rhum.)
La Loi et l’Ordre des empires terrestres sont remplacés par un code, le code des pirates, fondement de l’utopie qui miroite tel un mirage à l’horizon et dont la réalité évanescente est parfois, souvent (pas mal tout l’temps?) brutalement éphémère.
C’est l’utopie marine contre le nomos de la terre. Si la loi des empires contraint, le code des pirates libère, car c’est un guide plutôt qu’une règle, une boussole au lieu d’une loi formelle.
«Le droit est la prison du langage» écrit de Sutter; la fiabilité relative de la parole pirate en fait une ouverture des possibles: la subversion commence dans le langage même!
C’est ainsi qu’un accord passé avec un forban doit être pointilleux: l’honneur veut que la parole soit tenue, mais elle le sera que dans la mesure de ce qui a été dit. Point. Tout le reste n’est que fabulation. L’herméneutique flibustière n’est par ailleurs qu’un mélange inextricable de fables et de faits.
Ainsi, celui qui palabre le mieux (Sparrow) peut-il espérer être reconnu comme le plus grand de tous les forbans — que ce soit vrai ou non n’importe guère.
C’est aussi par la séduction que la légende se construit. Et celui qui l’a mieux compris (Sparrow encore) sait que l’on ne séduit pas: on crée les circonstances qui permettent au désir de naître! Dans la séduction, rien n’est vrai mais elle devient une réalité en soi et l’autre n’y voit que ce qu’il veut bien y voir. Le problème du séducteur (Sparrow, toujours), c’est qu’il aime être séduit. Il voit le piège mais ne peut résister d’y mettre le pied, la main ou… la langue 😉
En ce sens, la séduction vraie reste toujours un duel.
Séduire devient par ailleurs une stratégie de survie en soi, un moyen de «pirater le monde par le langage»…
Enfin, dans l’action, la multiplication des échecs et des conduites contre-exemplaires (de Sparrow, évidemment) ne fait qu’augmenter la légende, c’est ce que l’auteur appelle la «pragmatique du ratage»: rien n’est maîtrisé ou calculé, tout semble sonner faux et reposer sur le hasard ou l’improvisation, mais ça marche.
L’auteur le résume fort bien: «Le ridicule, dans le cas du capitaine, non seulement ne tuait pas, mais même le rendait plus fort»!
Et il rapporte cet échange entre le commodore Norrington et Jack:
«Vous êtes sans nul doute, annonce le commodore, le pire pirate dont j’aie entendu parler.
— Mais, rétorque Sparrow, vous avez entendu parler de moi…»